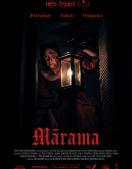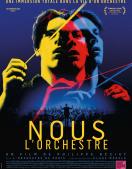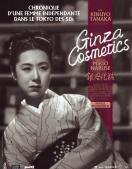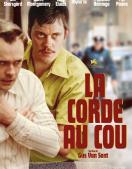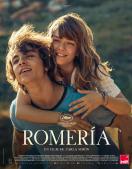Le temps des vérités
En 2024, l’AFCAE a organisé plusieurs rencontres avec l’ensemble des syndicats de distributeur·rices et la Médiatrice du cinéma. Si les échanges sur les plans de sortie, le nombre de séances et la répartition territoriale des points de diffusion ont été vifs, tous·tes les participant·es, conscient·es des tensions croissantes, ont reconnu la nécessité de poursuivre ces discussions dans un cadre plus formel, sous l’égide du CNC.
Parallèlement à d’autres initiatives similaires, comme celle portée par la branche de la petite exploitation, cette démarche a conduit le CNC à créer, en mai 2025, un comité de concertation. Dès juillet 2025, une première recommandation sur les avant-premières et les sorties anticipées a été publiée. Son application permettra d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ce comité. Pourtant, le travail ne fait que commencer. L’objectif affiché est ambitieux : « apaiser les tensions et rétablir le dialogue au sein de la profession ». Or, les défis sont nombreux à l’aube de cette fin d’année, avec un calendrier de sortie des films particulièrement chargé et des exigences croissantes des distributeur·rices en matière d’exposition.
Les premier·ères à en subir les conséquences sont les éditeur·rices des films les plus fragiles, qui peinent à trouver des écrans pour leurs œuvres, suivi·es par les salles, contraintes d’abandonner leurs actions Jeune Public ou répertoire, par manque de place sur leurs écrans.Mais c’est surtout le public qui est perdant, confronté à des plans de sortie massifs qui ne permettent plus la diversité inhérente à nos salles. Cette situation s’inscrit dans un contexte global de baisse des entrées, avec un recul de 15 % par rapport à 2024. Dans ce cadre, l’étude Hexacom, commandée par le nouveau Syndicat des Cinémas de Proximité (ex-Syndicat des cinémas du Centre-Sud), arrive à point nommé pour éclairer les réflexions de la profession et du comité. L’étude reprend en préambule un argument souvent avancé depuis plusieurs années : la fin des VPF et l’amplification des plans de sortie seraient en partie responsables des problèmes rencontrés actuellement dans l’exploitation française. Nous ne pensons pas qu’un système de régulation de l’accès aux films selon le nombre de salles soit la bonne solution. Un tel dispositif créerait une exploitation à deux vitesses, limitant les établissements disposant de peu d’écrans à ne programmer les films porteurs qu’à partir de la troisième, voire de la quatrième semaine.
Mais que révèle réellement l’étude Hexacom, menée sur 35 unités urbaines et plus d’une centaine de cinémas ? « En valeur absolue, les évolutions des entrées des cinémas de proximité et des grands circuits ne sont absolument pas comparables.» Les plus fortes hausses de fréquentation des salles de proximité ne dépassent pas 30 000 entrées, alors que les pertes des grands circuits se comptent souvent en centaines de milliers. La conclusion est sans appel : « Les difficultés actuelles de la grande exploitation dans les grandes agglomérations ne peuvent être imputées aux cinémas de proximité.» Les données actuelles montrent que le nombre de points de diffusion pour les films Art et Essai porteurs augmente, tout comme les tandems, tridems, voire plus de copies encore pour une même zone. Pourtant, cette multiplication des copies n’a qu’un effet marginal sur les entrées de ces films, voire un effet de dilution, impactant directement leur durée de vie en salle.
Après les constats, le comité de concertation doit être force de proposition pour, plus largement, repenser les rapports entre exploitant·es, distributeur·rices et public. Car nous sommes tous·tes les maillons d’une même chaîne, et c’est ensemble que nous devons agir pour le bien commun.
En premier lieu, l’AFCAE demande une répartition plus équilibrée de l’offre cinématographique. Aujourd’hui, la concentration des sorties s’adressant aux mêmes publics sur la période de septembre à décembre nuit à leur visibilité et écrase les spectateur·rices sous le poids d’une programmation trop dense. À l’inverse, à partir de mars, les propositions se raréfient et perdent en attractivité, ce qui contribue à un désintérêt progressif pour le cinéma. La mise en place d’un calendrier des sorties concerté permettrait une meilleure répartition des films sur l’année, ce qui aurait pour effet de lisser les entrées tout en offrant une meilleure visibilité aux films dans la presse et les médias, et donc une plus grande lisibilité pour les spectateur·rices.
Ce nouveau calendrier devra s’accompagner d’une refonte du
dialogue avec les distributeur·rices. Car force est de constater que nous sommes revenu·es, depuis la crise du Covid, à des pratiques d’arrière-garde : les demandes de séances se multiplient, voire imposent un retour au plein écran, au détriment de la diversité des programmations. Cette logique, qui vise à cannibaliser un marché déjà très concurrentiel, menace particulièrement les films des distributeur·rices les plus fragiles, mais aussi les films Jeune Public, les œuvres de répertoire, les documentaires, et les actions d’éducation artistique et culturelle (EAC), qui peinent désormais à trouver leur place sur nos écrans. Résultat : le caractère unique de nos salles est mis à mal, pour des résultats par séance toujours plus faibles.
Les chiffres le montrent : les entrées se concentrent autour de quelques films phares, au détriment d’une majorité d’œuvres qui restent invisibles. Pour inverser cette tendance, il faut sortir d’une logique de « coups » médiatiques et privilégier une approche de parcours, offrant aux spectateur·rices la possibilité de construire, film après film, rendez-vous après rendez-vous, une relation durable avec leur salle de cinéma. Ce parcours de spectateur·rices dans une année entière doit s’accompagner de temps d’animations, de rencontres et d’échanges qui sont le socle du travail Art et Essai, très demandés par le public.
Il faut également réarmer la presse cinéma pour qu’elle puisse jouer son rôle de prescripteur et de critique, car programmer des films qui bénéficient d’une très faible visibilité est contre-productif. Le travail des exploitant·es et des distributeur·rices doit être accompagné par un véritable travail éditorial de la presse spécialisée.
Cette réflexion sur notre filière ne pourra pas se suffire à elle-même. Il faudra que soit porté par le gouvernement un projet culturel des politiques publiques qui prenne en compte la réalité de l’exploitation actuelle : une exploitation où 200 millions de spectateur·rices pourrait ne plus être la norme mais l’exception, où les films américains et
les comédies populaires françaises ne performent plus autant et où le public populaire a déserté les salles de cinéma depuis la pandémie et l’avènement des plateformes.
Il est temps d’agir, ensemble, pour un cinéma plus diversifié, plus accessible et plus résilient.
Guillaume Bachy
Président de l'AFCAE